Par cœur est une série dans laquelle des auteurs partagent et discutent leurs passages de littérature préférés de tous les temps. Découvrez les entrées de Jonathan Franzen, Sherman Alexie, Andre Dubus III et plus encore.
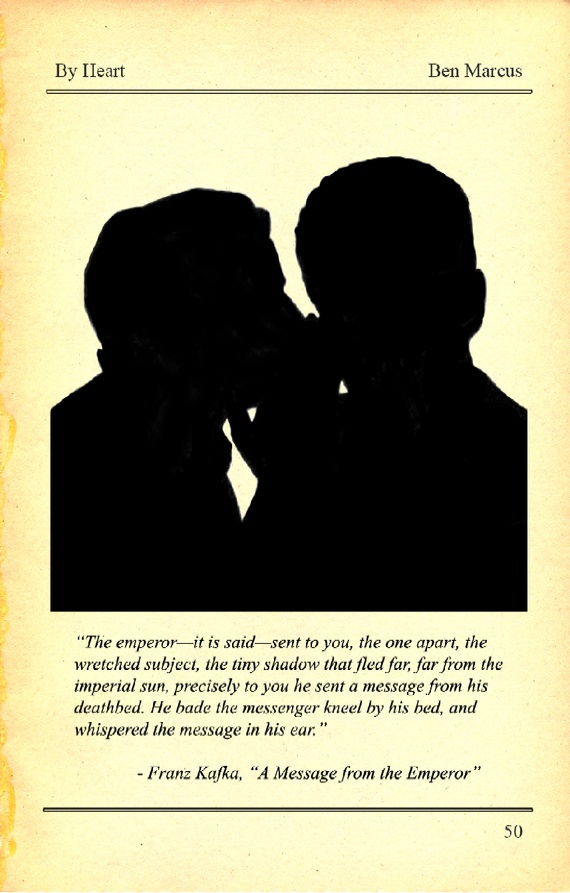
Les écrivains, lorsqu’ils nous touchent profondément, deviennent des adjectifs. Les visions de certains auteurs sont si reconnaissables qu’elles peuvent servir de raccourci : la réminiscence « proustienne », le bidonville « dickensien », le programme de surveillance « orwellien ». C’est peut-être utile, mais pas particulièrement précis. La grande littérature a tendance à être complexe et à faire l’objet de débats, et c’est peut-être pour cela que ces mots – des adjectifs éponymes, comme on les appelle techniquement – se prêtent si facilement aux abus.
Voyez, par exemple, l’omniprésent « kafkaïen ». Le nom de Kafka est « entré dans la langue d’une manière dont aucun autre écrivain ne l’a fait », a déclaré Frederick Karl, l’un des principaux biographes de Kafka, en 1991. (Le mot est même le titre d’un épisode de Breaking Bad.) Karl a qualifié le mot « d’adjectif représentatif de notre époque », mais s’est également plaint de son utilisation abusive : « Ce à quoi je m’oppose, a-t-il dit, c’est que quelqu’un aille prendre un bus et constate que tous les bus ont cessé de circuler et dise que c’est kafkaïen. Ça ne l’est pas. »
Ma conversation avec Ben Marcus, donc, était rafraîchissante. Il voulait discuter de « Un message de l’empereur », une courte parabole publiée pour la première fois en 1919, qui a été un modèle littéraire crucial pour lui ; sa discussion sur la pièce a finalement inclus un argument concis et brillant pour ce qui constitue le kafkaïen, bien qu’il n’ait jamais utilisé ce mot. Pour Marcus, les qualités quintessentielles de Kafka sont une utilisation affectueuse de la langue, un cadre à cheval entre le fantastique et la réalité, et un sentiment d’effort même face à la morosité – sans espoir et plein d’espoir.
Le nouveau recueil de Ben Marcus, Leaving the Sea, contient 15 histoires variées dans un éventail de modes. Marcus a été classé parmi les écrivains « expérimentaux » – en partie à cause d’un essai très lu dans Harper’s qui a frappé Jonathan Franzen et fait l’éloge d’un travail « difficile » – mais ce livre met en lumière Marcus dans sa forme la plus accessible. Ici, les récits simples (bien que troublants) trouvent leur place à côté de textures verbales denses, chaque pièce étant sa propre marque de prose lyrique et austère. Marcus enseigne la fiction au programme de maîtrise en écriture créative de l’université Columbia. Il m’a parlé par téléphone.
Plus dans cette série
Un message de l’empereur
L’empereur – dit-on – vous a envoyé, vous, l’être à part, le sujet misérable, l’ombre minuscule qui a fui loin, loin du soleil impérial, précisément à vous il a envoyé un message depuis son lit de mort. Il demanda au messager de s’agenouiller près de son lit et lui murmura le message à l’oreille. Il y tenait tellement qu’il le lui fit répéter à l’oreille. D’un signe de tête, il confirma l’exactitude des paroles du messager. Et avant que le public n’assiste à sa mort – tous les murs gênants ont été abattus et les grandes figures de l’empire se tiennent en cercle sur les larges escaliers extérieurs – avant tout cela, il envoya le messager. Le messager s’est mis en route immédiatement ; c’est un homme fort, infatigable ; en avançant tantôt un bras, tantôt l’autre, il s’est frayé un chemin à travers la foule ; chaque fois qu’il rencontre une résistance, il montre sa poitrine, qui porte le signe du soleil ; et il avance facilement, comme aucun autre. Mais les foules sont si vastes ; leurs habitations ne connaissent pas de limites. Si la campagne s’étendait devant lui, comme il volerait, et, en effet, vous pourriez bientôt entendre le magnifique coup de poing sur votre porte. Mais au lieu de cela, comme il peine inutilement ; il se fraie toujours un chemin à travers les chambres du palais le plus intérieur ; jamais il ne les vaincra ; et s’il y parvenait, rien ne serait gagné : il faudrait qu’il se batte pour descendre les marches ; et s’il y parvenait, rien ne serait gagné : Il devrait traverser la cour et, après la cour, le deuxième palais extérieur, et encore des escaliers et des cours, et encore un palais, et ainsi de suite à travers des milliers d’années ; et s’il devait enfin sortir par la porte la plus extérieure – mais cela ne peut jamais, jamais arriver – devant lui se trouve encore la capitale royale, le milieu du monde, empilé dans ses sédiments. Personne ne passe par ici, encore moins avec le message d’un mort. Vous, cependant, vous vous asseyez à votre fenêtre et rêvez du message quand le soir vient.
Exprimé de The Annotated Kafka, édité et traduit par Mark Harman, à paraître chez Harvard University Press. Utilisé avec la permission de l’auteur. Tous droits réservés. Cette traduction, copyright © 2011 par Mark Harman, est d’abord apparue sur le blog de la New York Review of Books, NYRblog (blogs.nybooks.com).
Ben Marcus : Je pense avoir lu pour la première fois les paraboles de Kafka dans un cours de philosophie à l’université. C’était probablement ma première exposition à Kafka. Les paraboles sont un point d’entrée puissant dans ce monde d’anxiété, de peur et de paranoïa, mais aussi le désir ardent, la beauté et l’étrangeté que je relie à l’œuvre de Kafka. La première parabole que j’ai lue est « Léopards dans le temple » – c’est une pièce très brève, belle et étrange et étrangement logique. Plus tard, j’ai trouvé « Un message de l’empereur », qui est devenu mon grand favori.
Il commence par une proposition convaincante. L’empereur, la plus grande figure de la civilisation, vous envoie un message. Cette configuration d’ouverture est captivante : Une personne extrêmement importante a quelque chose à vous dire, et à vous seul.
Mais la pièce se concentre sur l’impossibilité que ce message arrive jamais. Il s’avère que le palais comporte anneau sur anneau sur anneau de murs, des palais extérieurs successifs, et que le messager doit traverser l’un, puis l’autre, puis l’autre. S’il parvenait un jour à le faire – ce qu’il ne pourra jamais faire, le narrateur nous dit que le palais est trop vaste et impossible – alors il ne serait qu’au centre de la ville, qui est remplie de gens et d’ordures, toutes sortes d’obstacles difficiles à franchir. Il n’arrivera jamais à passer.
La fin est obsédante : Tu n’entendras jamais ce message qui t’est destiné à toi seul. Cela me brise le cœur. Quelque chose d’important t’a été communiqué, mais tu ne l’entendras jamais. Et pourtant, tu t’assiéras à ta fenêtre et tu le rêveras pour toi-même. Il y a donc un immense désir et un espoir couplés à un sentiment d’impossibilité et de futilité. Ces sensations incompatibles vous assaillent toutes en même temps. C’est tout simplement la perfection pour moi.
Il est difficile de ne pas voir que, à un certain niveau, « Un message de l’empereur » est une parabole sur la lecture. D’un côté, je suis réfractaire à l’idée de dire « tout ça, c’est à propos de ce que ça veut dire de raconter une histoire ! » – mais ça semble vraiment être là. J’aime y penser comme un rappel du fait que nous voulons désespérément qu’on nous parle. Nous voulons qu’on nous parle. Nous voulons qu’il y ait un message important pour nous. Et pourtant : combien il est futile d’espérer cela. L’histoire va au-delà d’une simple illustration du paradoxe littéraire : elle fait allusion à la difficulté suprême de se connecter véritablement à quelqu’un. Avec Kafka, il y a toujours cette sorte de futilité sombre, mais cette futilité ne semble jamais plate et pessimiste. Malgré l’impossibilité, nous avons toujours ce messager qui s’efforce héroïquement de percer. La parabole est une forme formidable pour capturer ce sentiment paradoxal.
Cette pièce est un modèle de ce que j’aimerais ressentir quand je lis. Et ce que je pourrais aimer que les autres ressentent, en lisant ce que j’ai écrit. Ce qui m’attire, c’est la façon dont il met en mouvement des sensations opposées, apparemment contradictoires, et les fait sentir compatibles contre toute attente. Le sentiment de difficulté, de futilité et d’obstacle énorme – associé à la recherche et au désir ardent et à l’espoir.
Et c’est cela l’écriture pour moi – la façon dont je peux lire un court morceau et me sentir transformé dans le peu de temps qu’il faut pour aller du début à la fin. Il y a des pièces d’écriture délibérément cérébrales que je trouve fantastiques et belles en elles-mêmes – mais pour moi, au final, j’ai besoin que la littérature me fasse ressentir des choses. Et pas seulement un peu. Je veux que l’écriture soit la forme la plus intense de sentiment que je puisse trouver. Comme si nous mettions des mots ensemble pour modifier, renforcer ou déclencher nos sentiments, afin de nous sentir plus vivants. C’est en partie pour cette raison que j’écris une histoire, que j’assemble des mots : parce qu’ils sont, en fin de compte, un mécanisme de transmission de sentiments intenses qui est énorme, voire inégalé. Le genre de sentiment dont trafique Kafka, je le trouve particulièrement attirant à cause de ses contradictions et de ses conflits, et à cause du mélange de peur et de beauté, les sensations apparemment incompatibles sont suspendues et maintenues en altitude et nous sont présentées.
Sans chercher à atteindre ce genre de sentiment, je ne sais tout simplement pas ce que je ferais. C’est ce que j’ai essayé de faire dans les courtes pièces de L’âge du fil et de la corde. La diction, la syntaxe et le langage que j’ai utilisés sont nés de mon intérêt pour ce qu’une seule phrase peut faire à notre tête et à notre cœur. Une seule phrase peut être pénétrante, presque comme une drogue lorsqu’elle entre en moi. Je lis, et au fur et à mesure que je lis, je me retrouve réarrangé, transporté et ému, comme si j’avais avalé une petite pilule. J’aime les phrases qui touchent instantanément mon système sanguin et me dérangent.
Je pense que la force émotionnelle de « Un message de l’empereur » est favorisée par la façon dont il se déroule dans un cadre indéterminé. Le monde décrit n’est pas le nôtre. Nous n’avons pas un empereur dans un palais avec des anneaux et des anneaux de cases que quelqu’un doit traverser. Kafka s’est éloigné de son propre monde, pour se tourner vers quelque chose d’ancien et de mythique. En même temps, il nous place dans l’histoire avec ce pronom « vous ». Il nous place à nos propres fenêtres, rêvant de ce que pourrait nous dire quelqu’un d’important, Dieu, une sorte de figure inconnue (dont il précise qu’elle est morte maintenant, le message a mis si longtemps à arriver).
C’est un exploit étonnant de défamiliarisation – nous ne sommes pas dans le monde réel, et pourtant le monde nous est entièrement familier – à partir d’histoires, de mythes, de légendes. C’est onirique. Il n’est pas inventé au point que l’on doive suspendre son incrédulité – il y a un sentiment de normalité, cette particularité banale qui est notre monde, en même temps qu’il est d’un autre monde. J’ai toujours aimé cet effet, parce que je commence très vite à prendre les choses pour acquises dans ma propre vie : je marche dans la rue, et j’arrête de penser à l’étrangeté d’un arbre. J’arrête de penser au fait qu’il est étrange de pouvoir marcher sur la surface de la terre sans en tomber. Ou à quel point c’est étrange que nous ayons construit toutes ces choses pour nous cacher dans ce qu’on appelle des maisons. Mais je commence à être attentif au monde, étonné par le fait même qu’il existe, lorsque j’essaie d’oublier ce que je sais. Si je peux trouver un moyen de me débarrasser de mes hypothèses, d’oublier ce que je sais, c’est un moyen de revenir dans le monde comme si je ne l’avais jamais vu auparavant. C’est délirant, c’est intense, c’est terrifiant d’essayer de voir le monde à nouveau. Mais c’est un espace littéraire que j’aime explorer.
Les gens veulent des choses différentes quand ils lisent, bien sûr, et je respecte cela. Il y en a dont le premier désir est de « comprendre » le sens de ce qu’ils ont lu. C’est une chose parfaitement légitime à vouloir. Mais une grande partie de ce que j’aime, je l’aime précisément parce qu’il échappe à la compréhension. Il est évident que vous ne voulez pas lire de la salade de mots, un texte qui ne veut rien dire. Mais j’ai tendance à rester captivé par les écrits qui ne sont pas si faciles à cerner, qui peuvent soutenir des lectures contradictoires, qui résistent à de nombreuses relectures. Nous pouvons traiter la littérature comme un produit destiné à se révéler dans son intégralité, immédiatement, et ce qui est formidable, c’est que nous avons cela. Vous pouvez aller dans n’importe quelle librairie et identifier ce que vous voulez, vous pouvez l’obtenir. C’est disponible. Mais il y a aussi des choses plus énigmatiques. Je pense qu’il y a de la place pour tout cela.
Un bon exemple récent est le dernier roman de J. M. Coetzee, L’Enfance de Jésus. J’ai vu des commentaires étranges et dédaigneux sur ce livre – beaucoup de critiques n’étaient pas contents. Mais je pense qu’il est si captivant, si étrange, si convaincant. Coetzee est un autre écrivain, comme Kazuo Ishiguro, qui peut vous emmener dans une sorte d’espace kafkaïen au contexte indéterminé : Dans ce cas, un type arrive dans une colonie avec un enfant. Il n’y a pas de passé, il n’y a pas de contexte, il n’y a pas de flash-back – toute explication est retenue. C’est une rupture de contrat pour certains lecteurs. Et pourtant, pour moi, c’est l’absence de ce genre de choses qui me captive. Cela me fait me sentir attiré et curieux.
La curiosité est une chose intéressante. Dans les cours que j’enseigne, l’une des choses courantes que l’on entend est la suivante : Si vous parlez d’une histoire, quelqu’un va dire : « Eh bien, ce personnage John. Je voulais en savoir plus sur lui. » C’est une demande courante – demander plus d’informations sur un personnage. Mais disons que vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur ce personnage. Toutes les données que vous pouvez donner : Donnons les flashbacks, montrons l’enfance. Est-ce que ça rendrait l’histoire meilleure ? Pour moi, ce n’est pas si simple. Vous pouvez inonder le texte d’informations, mais cela n’améliore pas l’expérience littéraire, le drame. Je pense que certains lecteurs sont prêts à vivre avec un certain degré de curiosité insatisfaite – la curiosité vous pousse à aller de l’avant – mais d’autres trouvent cette rétention ennuyeuse. Ils veulent savoir, dans le cas de Coetzee, eh bien, attendez, le garçon Simon est-il vraiment Jésus ?
Ce qui est intéressant dans ce roman, en particulier, c’est la quantité de travail que fait le titre. Parce que nulle part dans le livre il n’est suggéré de manière explicite que Simon est censé être Jésus en tant que jeune garçon. Mais le fait que le livre s’intitule L’enfance de Jésus est constamment présent, vous saisissant et vous rappelant que vous lisez quelque chose de très probablement beaucoup plus profondément lié à la mythologie que vous ne pourriez le penser. Ce livre a eu un effet troublant sur moi. J’admire le peu de contexte que Coetzee utilise et pourtant le caractère fascinant de son monde actuel. Il vous emmène à un moment qui est si rigoureusement vide tout autour de lui – et pour moi, c’est une expérience très proche de celle de Kafka.
Je ne ressens généralement pas le besoin de savoir de manière critique de quoi quelque chose » parlait « , et je préférerais de loin être emmené à travers quelque chose de mystérieux. Mais si je me retrouve à être » certain » que c’est ce que j’aime lire, et ce que j’aime faire – je pense que c’est un endroit terrible à être. C’est exactement à ce moment-là que je commence à penser, maintenant, j’ai besoin d’allumer tout ça. Voir ce que je rate en me lançant à fond dans cette approche. Je corrige constamment le tir, en fonction de ce que j’ai écrit précédemment. Je cherche toujours à essayer quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant – et à travers cela, à vivre quelque chose que je n’ai jamais vécu auparavant. Je m’inquiète donc si je commence à donner l’impression de propager une vision unique de ce que peut être l’écriture. Si j’ai écrit ou lu des phrases maniérées et étranges pendant un certain temps, peut-être ai-je besoin d’essayer des phrases très simples qui se cachent à la vue de tous.
Parce qu’il y a un degré auquel les moyens et les méthodes de la littérature sont inconnaissables. Nous ne savons pas ce qui se passe quand quelqu’un lit un poème. Nous savons que même si un écrivain travaille et travaille pour faire un texte précis, beaucoup sera perdu dans la transmission – nous n’aurons aucune idée réelle, même, de la quantité qui passe. Cela me donne un immense respect pour la difficulté et la variété du langage. Les écrivains pensent que si vous placez les mots dans un certain ordre, vous allez transporter les lecteurs : Vous allez leur donner des sentiments, vous allez leur donner des sensations, vous allez faire vibrer des choses profondes dans leur imagination. Et pourtant, nous ne pouvons pas le systématiser. Nous ne pouvons pas dire, ok, c’est exactement comme ça que vous écrivez une bonne nouvelle. C’est exactement comme ça qu’on écrit un roman. Les œuvres littéraires doivent être comme ceci, et pas comme cela. Nous pouvons débattre de ces choses, mais ce n’est pas parce que quelque chose fonctionne bien une fois que vous pouvez le répéter. La façon dont les livres s’assemblent est, pour moi, ineffable. Le fait que je puisse en savoir si peu sur ce processus, et pourtant me sentir si attiré par lui – eh bien, c’est ce qui me pousse à revenir.
Lorsque je lis la parabole de Kafka, je ressens de l’étrangeté et de la beauté, je ressens de la peine. C’est inventif, et pourtant l’invention est attachée à un sentiment profond, plongeant. Ce sont les valeurs importantes pour moi : quand quelque chose d’autre que le monde s’accroche à vous émotionnellement. Pour moi, c’est un texte parfait.