Landing on Water (1986)
Si d’autres grands noms des années 1970, dont Don Henley, connaissaient des succès dans les années 1980 avec des disques modernes et lourds en synthétiseurs, alors pourquoi Neil Young ne s’y essaierait-il pas ? Une question à laquelle la réponse évidente est : parce que cela pourrait ressembler à Landing on Water, sur lequel des chansons parfaitement bonnes – notamment le portrait dévastateur de David Crosby dans sa ruine cokéfiée qu’offre Hippie Dream – ont été anéanties par une production stérile et antipathique.
Everybody’s Rockin’ (1983)
Comme un monumental doigt d’honneur à une maison de disques qui avait exigé un album « rock » de Young, le rockabilly et le R&B de Everybody’s Rockin’ est assez impressionnant. En tant qu’expérience d’écoute, pas tant que ça. La production numérique est horrible ; la reprise de Bright Lights Big City de Jimmy Reed abyssale.
Old Ways (1985)
Il a ses moments, My Boy et Are There Any More Real Cowboys ? entre autres, mais le disque country des années 80 de Young – produit à nouveau, semble-t-il, principalement pour ennuyer son label de l’époque, Geffen – est surproduit, sirupeux et cliché au point de paraître condescendant. Il vaut mieux oublier qu’il a ensuite courtisé le marché conservateur de Nashville en faisant des déclarations réactionnaires dans des interviews.
Are You Passionate ? (2002)

Cette collaboration avec Booker T and the MGs, qui a attiré beaucoup d’attention pour le thème belliqueux et post-11 septembre de Let’s Roll, est autrement oubliable : des chansons mid-tempo compétentes et sans but ; peu de frissons. Le soulagement arrive lorsque Crazy Horse lumber sans grâce en vue sur Goin’ Home.
Peace Trail (2016)
On ne peut pas blâmer l’éthique de travail récente de Young, ou son engagement politique, mais Peace Trail – son deuxième album de 2016, en partie inspiré par les protestations environnementales à la réserve de Standing Rock – était un gâchis : écriture sommaire, idées musicales à moitié cuites, y compris un éclat de voix Auto-Tuned, paroles platitudes. Bonne chanson-titre, cependant.
Life (1987)
Après avoir entravé Landing on Water par une application maladroite de synthés et de boîtes à rythmes, Young a procédé à l’entrave d’un album avec ses vieux camarades Crazy Horse exactement de la même manière. C’est exaspérant car les chansons étaient souvent excellentes, comme en témoigne Prisoners of Rock and Roll, un manifeste virtuel de l’approche musicale primitive du Crazy Horse : « We don’t wanna be good. »
Fork in the Road (2009)
« Je suis une grande rock star, mes ventes ont chuté / Mais je t’ai toujours – merci », propose Young sur le morceau titre. Il n’est rien si ce n’est honnête, mais ses ventes auraient peut-être mieux résisté si ses derniers albums n’avaient pas sonné de plus en plus décousus, avec plus de réflexion sur leurs messages – ici sur la pollution et la crise financière en cours – que sur la musique.
Broken Arrow (1996)
Il existe une théorie omniprésente selon laquelle la musique de Young a souffert depuis la mort de son producteur de longue date, David Briggs, le seul homme qui semblait capable de le brider et d’appeler ses idées les moins inspirées. Il est certain que le premier album qu’il a fait après la mort de Briggs semblait tentaculaire et sans direction : de longs jams du Crazy Horse côtoyant des morceaux live de qualité bootleg.
Paradox (2018)
Le film incohérent de Darryl Hannah sur Young et ses derniers jeunes collaborateurs, Promise of the Real, est un test d’endurance pour rivaliser avec le documentaire sans but similaire Journey Through the Past de 1972, mais la bande-son – un patchwork de passages instrumentaux, d’outtakes et d’enregistrements live – est assez immersive et agréable lorsqu’elle dérive, bien que clairement seuls les fous purs et durs de Young doivent s’appliquer.
Colorado (2019)
Le dernier d’une succession d’albums médiocres avec le Crazy Horse, Colorado présente quelques performances incendiaires dans le style hamfisted patenté du groupe – il y a un moment au milieu de She Showed Me Love où le batteur Ralph Molina semble arrêter de jouer par erreur – mais il présente aussi des paroles politiques douloureusement sur la pointe des pieds, et pas grand-chose en termes de morceaux décents.
Storytone (2014)

L’indécision a plombé Storytone, que Young a sorti en trois versions : une orchestrée, une dépouillée, une avec un peu des deux. Peut-être s’est-il rendu compte que le concept initial de Neil Young-as-crooner de l’album ne fonctionnait pas tout à fait, oscillant comme il le faisait entre le charme (le I Want to Drive My Car alimenté par un big band) et le schlocky (Tumbleweed).
Prairie Wind (2005)
Le moins attrayant des albums de Young dans la veine Harvest, Prairie Wind reste l’un des albums les plus forts de Young à la fin de sa carrière. L’ambiance automnale et réfléchie de He Was the King et This Old Guitar a vraisemblablement été influencée par la mort de son père et par le propre contact de Young avec la mortalité après un anévrisme cérébral.
Silver & Gold (2000)
Encore un album dans la veine country-rock de Harvest. Les points forts sont élevés – la clôture broyeuse Without Rings est particulièrement fine – mais il y a beaucoup de remplissage, et la nostalgie teintée de rose de l’hymne de Young à son ancien groupe, Buffalo Springfield Again, est particulièrement liquide.
Greendale (2003)
Salué par certains comme un retour à la forme – ce qui signifiait simplement une amélioration par rapport à son prédécesseur terne, Are You Passionate ? – Greendale était l’opéra rock de Young, un titre grandiose qui semblait antithétique à son son rugueux et bluesy. L’écriture des chansons est trop inégale pour soutenir l’intérêt : Be the Rain et Bandit sont formidables ; Grandpa’s Interview interminable.
Arc (1991)
C’est Thurston Moore, de Sonic Youth, qui a suggéré à Young de sortir un album live entièrement composé des intros et outros chargés de larsens de ses prestations live. Mixé en studio en un seul morceau de 35 minutes, ce n’est pas tout à fait une déclaration aussi conflictuelle que Metal Machine Music de Lou Reed, mais cela vaut la peine de l’écouter au moins une fois.
The Monsanto Years (2015)
Le dernier backing band de Young, Promise of the Real, sonne ici avec fougue, et Young lui-même est audiblement livide, mais The Monsanto Years était un autre album qui semblait précipité au point que l’écriture réelle avait été négligée. Les paroles – faisant pleuvoir le feu sur les OGM – ressemblent souvent plus à des billets de blogs délirants mis en musique qu’à des chansons.
Trans (1982)
Inspiré par son fils tétraplégique Ben, un album concept électronique de Neil Young avec des voix vocodées était une démarche incroyablement audacieuse, à tel point que Young l’a étoffé avec du matériel plus direct. Le résultat final était un curieux désordre ; la beauté de Transformer Man n’a été pleinement révélée que lorsque Young l’a joué en acoustique lors de l’émission MTV Unplugged de 1993.
Hawks & Doves (1980)
Distrait par des conflits familiaux, la suite de Young au classique Rust Never Sleeps était une collection ébouriffée d’airs country jetés ensemble et de chutes diverses. Hawks & Doves est sauvagement inégal, son morceau-titre carrément affreux, mais les bons morceaux – le sinistre Captain Kennedy, le magnifique Lost in Space, la longue allégorie de The Old Homestead sur sa propre carrière – sont fantastiques.
Mirror Ball (1995)
Nettement fier de son étiquette de » parrain du grunge » – la combinaison de relâchement et d’intensité du Crazy Horse a été une influence clé sur le son – Mirror Ball a vu Young collaborer avec Pearl Jam. Les résultats étaient solides, mais jamais assez explosifs ou nerveux pour vous empêcher de souhaiter qu’il ait choisi de travailler avec ses anciens compagnons de tournée Sonic Youth, qui auraient pu le pousser plus fort.
Chrome Dreams II (2007)
Classique Neil : 30 ans après avoir refusé de sortir un album appelé Chrome Dreams, il sort une suite. Chrome Dreams II s’articule autour d’un seul titre, l’étonnant Ordinary People de 18 minutes. Enregistré en 1987, il jette la plupart des morceaux plus récents de l’album sous une lumière impitoyable, mais le Dirty Old Man, éreinté et ultra-distorsionné, tient la route.

Americana (2012)
Un album largement composé de folksongs dramatiquement réassemblés – Clementine et Oh Susanna notamment – Americana est sporadiquement génial, occasionnellement bâclé et parfois véritablement surprenant. De façon assez improbable, il se conclut avec Crazy Horse qui met en scène God Save the Queen, comme dans l’hymne national britannique, et non la chanson des Sex Pistols.
Neil Young (1968)
« Overdub city », protestait Young à propos de ses débuts en solo, et il avait raison. Il est rempli de chansons fantastiques que Young reprendra à plusieurs reprises en concert – The Loner, Here We Are in the Years, The Old Laughing Lady – mais gémit fréquemment sous le poids des arrangements élaborés de Jack Nitzsche. À partir de ce moment, Young privilégiera la simplicité et la spontanéité.
Psychedelic Pill (2012)
Crazy Horse s’est fait connaître en jouant des jams prolongées, une approche que Psychedelic Pill a poussée à l’extrême : l’ouverture ici, Driftin’ Back, se prolonge pendant la meilleure partie d’une demi-heure. Qu’il justifie cette longueur est une autre question, bien que Ramada Inn, qui pointe à seulement 16 minutes, soit formidable.
Dead Man (1995)
La première bande originale de film de Young, Journey Through the Past de 1972, était un méli-mélo d’enregistrements live et de chutes qui a réussi à horrifier les fans qui pensaient qu’il s’agissait de la suite de Harvest. Interprété en direct sur un montage brut du western surréaliste Dead Man de Jim Jarmusch, c’est autre chose : un long instrumental de guitare austère et parfois violent.
American Stars ‘N Bars (1977)
Le plus faible des albums studio de Young dans les années 1970, American Stars ‘N Bars associe des morceaux tirés de Homegrown, alors inédit, à des enregistrements domestiques lo-fi (l’étrangement flippant Will to Love), du country-rock plombé et un classique incontesté du Crazy Horse : Like a Hurricane (bien qu’il existe de meilleures versions live).
A Letter Home (2014)
Cela semble être une nouveauté – Young enregistrant des reprises dans une cabine d’enregistrement de vinyle de 1947 appartenant à Jack White – mais A Letter Home fonctionne, sautant de chansons que Young aurait jouées en tant que chanteur folk de café, comme Needle of Death de Bert Jansch, à une version obsédante de My Hometown de Bruce Springsteen.
Living With War (2006)
Swiftly recorded and released, backed by a 100-voice choir, the anti-Iraq war tirade Living With War finds Young sounding energised by the urgency of his undertaking and, one suspects, by the furore he must have known it would cause. Une tournée ultérieure de Crosby Stills Nash & Young lourde de ce matériel a été accueillie par des huées et des walkouts de leurs fans les plus conservateurs.
Re-ac-tor (1981)
Un album du Crazy Horse grinçant, sombre et répétitif (délibérément ; il est influencé par un programme de traitement épuisant subi par le fils de Young), Re-ac-tor est un travail difficile, parfois peu inspiré et parfois magnifique, comme sur le vacarme féroce de Surfer Joe et Moe the Sleaze et la conclusion Shots.
Harvest (1972)
Que l’énorme succès commercial de Harvest ait déclenché chez Young un accès de comportement volontaire, voire contrariant, n’est pas si inexplicable : il savait vraisemblablement que son plus grand album était loin d’être son meilleur. Les chansons varient de fantastiques (la chanson titre ; Words) à oubliables, tandis que les arrangements sont lisses mais parfois exagérés, comme sur A Man Needs a Maid.
This Note’s for You (1988)
De loin la plus réussie des expériences de genre de Young dans les années 80, et une renaissance créative en quelque sorte, l’album bluesy R&B est surtout connu pour son titre, une éviscération du penchant croissant du rock des années 80 pour le sponsoring des entreprises, mais ses meilleurs moments sont subtils et discrets : l’atmosphérique Twilight, la mélancolie des petites heures de Coupe De Ville.
Hitchhiker (1976)
Le son de Young seul en studio, « ouvrant le robinet » comme le dit David Briggs, et laissant les nouvelles chansons se déverser (presque toutes ont fini par être réenregistrées ailleurs). Le fait que Young soit audiblement, héroïquement défoncé tout au long de l’album ne fait qu’ajouter au charme intime de l’album.
Le Noise (2010)
Produit par Daniel Lanois, c’est le meilleur album de Young du 21e siècle, et il l’a emmené dans un nouvel endroit. Lanois a ajouté de temps en temps une boucle de bande désorientante, tandis que Young s’accompagne d’une guitare électrique distordue, dont il joue clairement à un volume qui lui coupe les oreilles. Apporter cette fraîcheur d’approche à un album solo d’auteur-compositeur-interprète a donné lieu à du matériel solide.
Harvest Moon (1992)
Harvest Moon est meilleur que l’album classique auquel son titre faisait référence, et dont il a réassemblé les backing musicians. Le son convient aux chansons, qui sont nostalgiques et striées de nostalgie. La chanson-titre, dont le riff a été piqué au Walk Right Back des Everly Brothers, est un hymne authentiquement beau au mariage et à l’amour durable.
Ragged Glory (1991)
Crazy Horse à son état le plus joyeusement primitif – Young aurait enregistré sa voix debout dans un tas de fumier de cheval – se déchaînant sur des standards du garage-rock (Farmer John des Premiers), des jams émeutiers (Love and Only Love, Mansion on the Hill) et des hymnes à leurs propres limites (F!#*in’ Up). Une explosion du début à la fin.
Homegrown (1975)
« Sometimes life hurts », écrit Young pour expliquer la sortie tardive de Homegrown en 2020, 45 ans après l’avoir enregistré au lendemain de sa séparation avec l’actrice Carrie Snodgrass. Il est certes abattu, son ton étant donné par l’ouvreur Separate Ways, mais c’est aussi Young au sommet de ses pouvoirs, écrivant des chansons fragiles et magnifiques.
Comes a Time (1978)
L’album country-rock doux que sa maison de disques aurait sans doute souhaité qu’il sorte pour faire suite à Harvest, Comes a Time est bien meilleur que son prédécesseur spirituel. Il est plus rugueux sur les bords – le Crazy Horse se montre sur les merveilleux Lotta Love et Look Out for My Love – et abrite une paire de classiques de Young, dont la chanson-titre.
Freedom (1989)
Après des années 1980 confuses, l’étonnant retour de Young à la pleine puissance rageuse tombait à point nommé, carillonnant avec le mouvement grunge naissant qu’il a contribué à inspirer. Le très mal interprété Rockin’ in the Free World a été le tube, mais Freedom regorge de morceaux qui tuent, du long Crime in the City (Sixty to Zero), soutenu par des cuivres, à une reprise féroce de On Broadway, avec des retours.
Sleeps With Angels (1994)
La lettre de suicide de Kurt Cobain citait un texte de Young, à la grande horreur de son auteur ; le titre de Sleeps With Angels était sa réponse bouleversée. Le reste de l’album est aussi fascinant et effrayant que son travail du milieu des années 70, avec un Crazy Horse étonnamment discret. Piece of Crap, quant à lui, présente Young en refusenik grincheux d’âge moyen, un rôle qu’il habitera fréquemment.
Time Fades Away (1973)
Seul Neil Young ferait suivre sa percée commerciale d’une audiovérité chaotique souvenir d’une tournée désastreuse. Mais Time Fades Away n’est pas seulement un geste d’enterrement, il est tout à fait convaincant. Les chansons – le brouhaha hippie de Last Dance, la fragile ballade au piano The Bridge, et l’autobiographique Don’t Be Denied – sont incroyables, potentialisées par les performances échevelées.
Zuma (1975)
Ton plus léger que la » trilogie des fossés » (Time Fades Away, Tonight’s the Night et On the Beach) qui l’a précédé, Zuma a réuni Young avec un Crazy Horse revitalisé, suscitant la glorieuse évocation de Barstool Blues d’un esprit ivre qui serpente et l’épopée historique sombre et majestueuse Cortez the Killer. Et sa clôture lambda Through My Sails est la dernière vraie grande chanson que Crosby Stills Nash & Young a publiée.
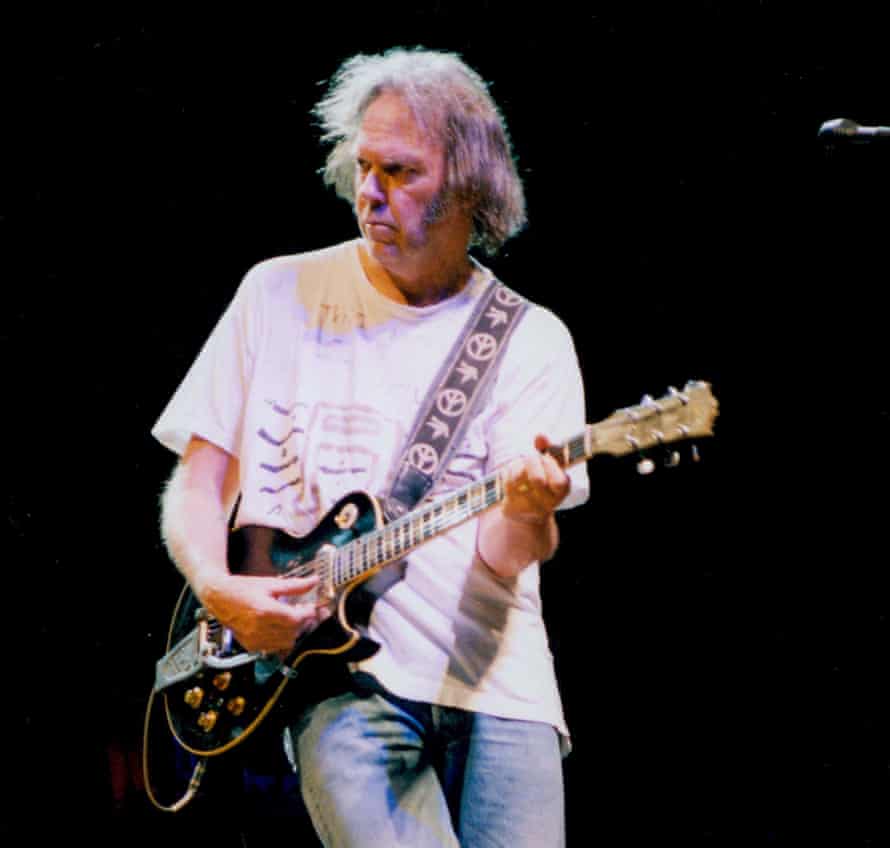
After the Gold Rush (1970)
After The Gold Rush ressemble à l’album du lendemain des années 60 de Young, mais contrairement au ton consolateur de Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel, il est décharné, troublé et touchant. Au milieu des malheurs relationnels, il y a le désastre écologique, le racisme et Don’t Let It Bring You Down, qui, a noté Young, était « garanti pour vous faire tomber ».
On the Beach (1974)
Désespérant et inconsolable, mais mis en musique de façon magnifique : le piano électrique chatoyant de See the Sky About to Rain, la conclusion acoustique épique Ambulance Blues ( » You’re all just pissing in the wind « , conclut-elle), la prise de rock défoncé et brumeux de la chanson titre. Par contraste, il y a Revolution Blues, un portrait féroce et sans pitié de Charles Manson, une vieille connaissance de Young.
Tonight’s the Night (1975)
La réponse sans filtre, imbibée de tequila, de Young aux décès du guitariste du Crazy Horse Danny Whitten et de leur roadie Bruce Berry est une écoute déchirante, extraordinairement puissante, la raucité alcoolisée des performances correspondant à l’émotion brute des chansons. Le moment où la voix de Young se fissure pendant Mellow My Mind est peut-être le plus puissant de son catalogue.
Everybody Knows This Is Nowhere (1969)
Le premier album de Young avec le Crazy Horse est un album incroyable : la puissance pure de ses chansons et de son son ; le riff assassin de Cinnamon Girl ; la façon dont le jeu sur les jams prolongées Down By the River et Cowgirl in the Sand incarne leur angoisse lyrique, gardant l’auditeur complètement saisi même lorsqu’elles dépassent les 10 minutes.
Rust Never Sleeps (1979)
La frontière entre les albums live et studio de Young a toujours été flexible. Rust Never Sleeps a été enregistré sur scène en 1978, puis overdubbed. En vérité, la plupart de ses albums des années 70 pourraient être considérés comme ses meilleurs – il a maintenu un niveau remarquablement élevé – mais Rust Never Sleeps offre un résumé parfait de tout ce qui fait sa grandeur, sa qualité étant peut-être stimulée par le mouvement punk auquel il fait référence sur Hey Hey, My My (Into the Black) et, de manière plus elliptique, sur Thrasher. La séquence de chansons acoustiques de la première face est à couper le souffle, et le Crazy Horse fait rage dans un style tonitruant sur la deuxième face, qui abrite la saga déchirante de Powderfinger sur la violence, la mort et les liens familiaux – sans doute sa plus grande chanson.